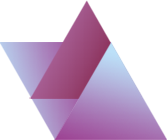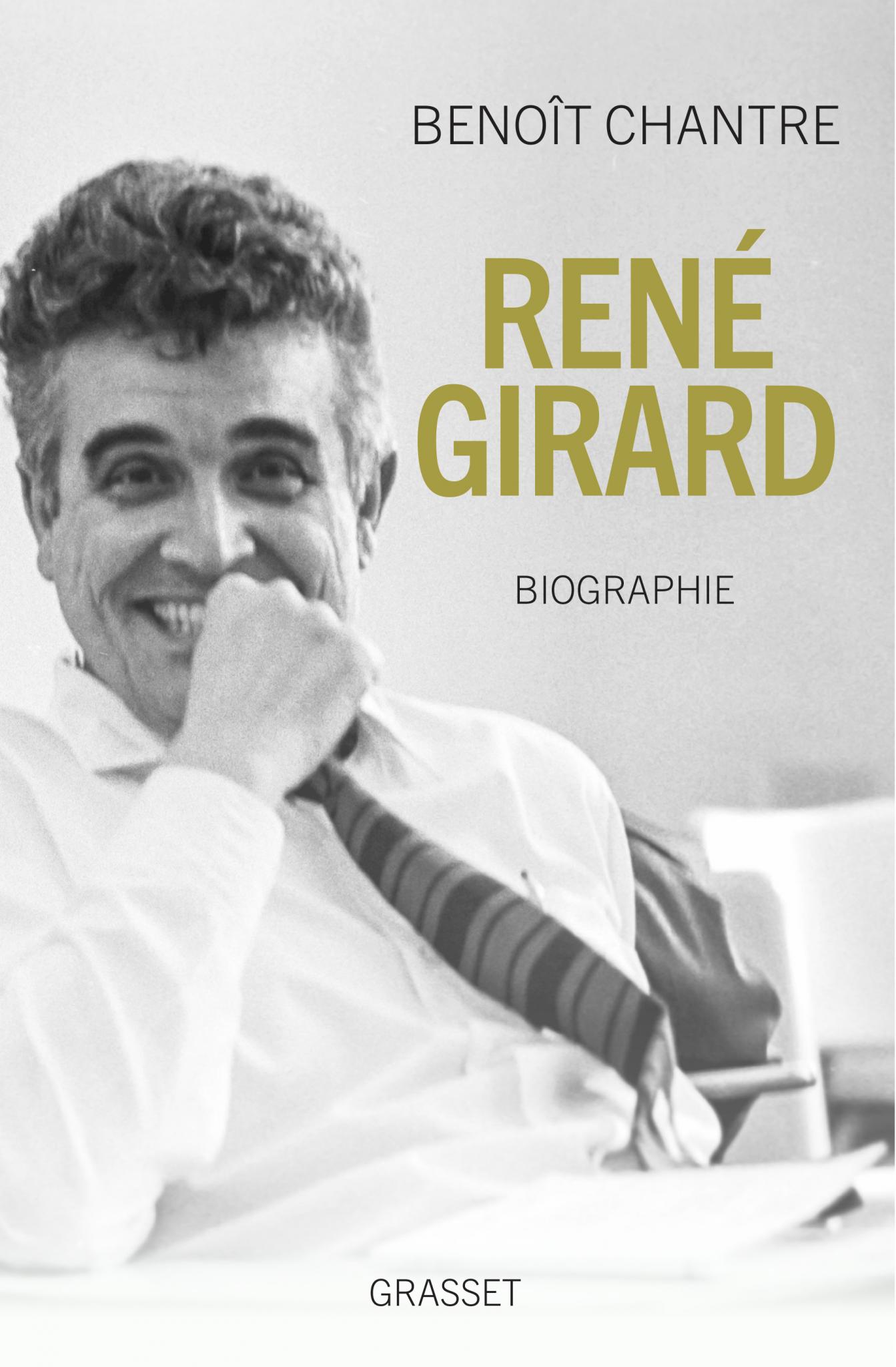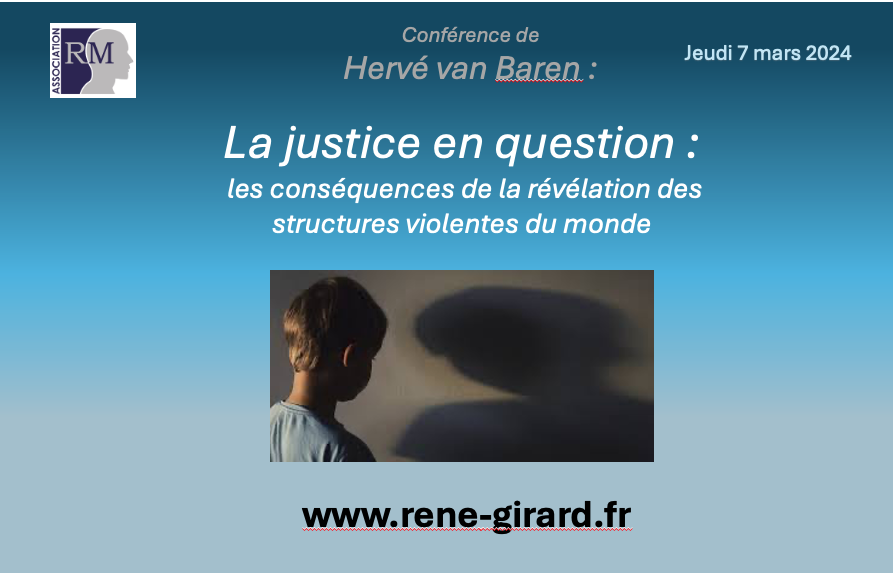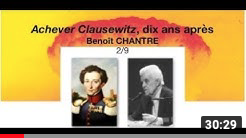Evénements
Un livre, une conférence
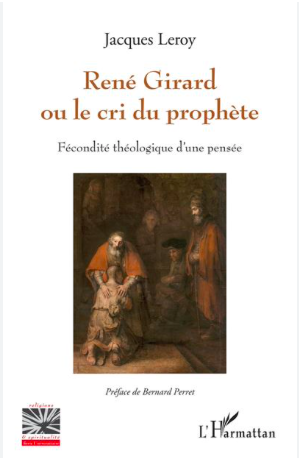 René Girard ou le cri du prophète
René Girard ou le cri du prophète
de Jacques Leroy-Berger
paru aux éditions L’Harmattan,
Mercredi 7 décembre, à 19h, par zoom
Discussion autour du livre de Jacques Leroy, avec Samir Arbache et Bernard Perret
Le principal apport de René Girard à la théologie est d'avoir contribué à débloquer une situation qui paraissait sans issue : celle d'une doctrine de la Rédemption présentant un Dieu qui réclamerait le sacrifice de son fils pour effacer la tâche originelle et « calmer son courroux », comme le dit si bien le chant du Minuit chrétien.
La question se pose toutefois de savoir si la thèse de Girard peut s'inscrire dans la tradition de la foi chrétienne bien qu'elle paraisse s'opposer à une conception transmise à des générations de chrétiens. Pour répondre à cette question, il suffit de mesurer la fécondité théologique de la thèse girardienne, reçue comme source d'inspiration par de nombreux théologiens de toutes confessions chrétiennes.
Le livre de Jacques Leroy donne un aperçu de cette fécondité à partir de l'analyse des travaux de douze théologiens parmi les plus représentatifs du courant girardien. Plus que d'une suite de comptes rendus, il s'agit d'une synthèse raisonnée qui permet à l'auteur de faire valoir sa propre lecture des implications de l' œuvre de René Girard pour le christianisme.
Jacques Leroy : Docteur en philosophie
Samir Arbache :Professeur en théologie et histoire des religions, docteur en philosophie et lettres : études sur le monde arabe – Université Catholique de Lille.
Bernard Perret : Essayiste, ARM.
Extrait du livre - Table des matières
La Chine et ses démons. Aux sources du sino-totalitarisme
d’Emmanuel Dubois de Prisque,
paruaux éditions Odile Jacob
Samedi 17 décembre à 15h30
Discussion avec Emmanuel Dubois de Prisque, Jean-louis Salasc et Benoît Chantre
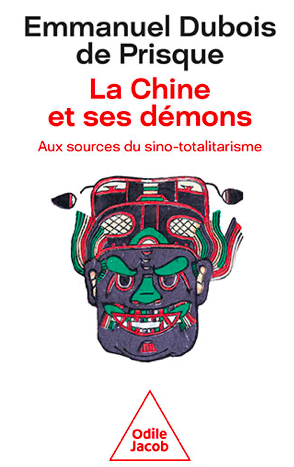
Le régime communiste chinois n'hésite plus guère à se réclamer de la longue tradition culturelle et civilisationnelle de l'Empire. Dans le même temps, il s'efforce d'effacer la marque occidentale et chrétienne, par le truchement de sa politique de « sinisation des religions »,du corps sociopolitique chinois. Est-il possible de prendre cette prétention au sérieux ? Peut-on mettre en lumière une continuité entre la gouvernance politico-religieuse de l'Empire et la gouvernance « scientifique » du Parti communiste aujourd'hui ? Ces deux gouvernances sont-elles unies par une économie de la violence que la théorie mimétique de René Girard permettrait de comprendre ?La force apparente du système sacrificiel chinois lance-t-elle un défi de plus à un Occident sous les feux d'une critique quasi-universelle?
Cette conférence sera précédée à 14h30 par l'AG de l'ARM.
PARUTIONS
Girard et quelques autres...
Ce cycle, organisé par Jean-Marc Bourdin, coïncide avec la publication prévue en 2022 du premier volume d’un ouvrage collectif aux Editions Michigan State University Press, réalisé sous la direction de George Dunn et Andreas Wilmes, intitulé René Girard and the Occidental Philosophy.
Ce cycle renoue, selon cette nouvelle formule, avec une tradition de l’ARM qui a organisé depuis sa création de nombreux colloques et journées d’études à confronter la pensée de René Girard (1923-2015) à celle de grands penseurs contemporains. Vous pouvez revoir ces colloques sur notre site dans l'onglet "Recherche".
Avec Tocqueville, fréquemment cité dans l'œuvre de René Girard, sera examinée la possibilité d’une anthropologie politique mimétique. Avec Michel Serres, il sera question de la fécondité d’une longue amitié, en particulier à propos de questions épistémologiques. Avec Pascal, scientifique et métaphysicien, il s’agira d’évaluer une relation moins évidente qu’il n’y paraît. Avec Hegel, précisément évoqué dans Mensonge romantique et vérité romanesque et Achever Clausewitz, on se demandera si le philosophe du désir de reconnaissance est un précurseur de la théorie mimétique, question qui se pose également avec Spinoza qui, parmi les premiers, a mis le désir au cœur des rapports humains dans son Éthique. En associant in fine le contemporain Derrida, ce parcours sera provisoirement conclu par une interrogation plus générale sur les affinités philosophiques, à l’origine de notre cycle.
Jeudi 17 mars 2022 : Jean-Marc Bourdin
“Tocqueville et Girard, les deux transatlantiques”
Tocqueville est mentionné par Girard tout au long de son œuvre. Fait significatif, Tocqueville apparaît sur la scène girardienne en 1960 lors d’une conférence où il est étroitement associé à Stendhal : il est hissé à la hauteur de son contemporain, qualifié de romancier génial, en raison de son observation et de sa compréhension des mécanismes mimétiques du désir et de la vanité. Seul de son espèce ou presque parmi les essayistes, Tocqueville aurait ainsi partagé la lucidité de quelques romanciers et dramaturges sans recourir à la fiction. Girard va même lui concéder une forme de supériorité dans Mensonge romantique et vérité romanesque : immunisé contre les poisons partisans, il ne serait pas loin d’expliciter une vérité historique et politique qui reste implicite chez Flaubert et Stendhal.
Tocqueville est donc un invité régulier dans les ouvrages de Girard : ce dernier voit dans la tendance millénaire à l’égalité des conditions, thèse majeure de Tocqueville, le pendant sociologique de sa psychologie interdividuelle fondée sur la mimésis d’appropriation : une communauté anthropologique est de fait envisageable entre les deux théories.
Girard affirme par ailleurs dans un entretien que“s’il y a une science politique, c’est Tocqueville”. Il est alors tentant de se demander si Tocqueville n’aurait pas répondu par avance à l’objection souvent faite à la théorie mimétique qui aurait le politique comme angle mort.
Jean-Marc Bourdin est docteur en philosophie, auteur de "René Girard, promoteur d’une science des rapports humains".
Jeudi 28 avril 2022 : Olivier Joachim
“René Girard/Michel Serres : concordances”
L’extraordinaire proximité entre René Girard et Michel Serres rend la ‘confrontation’ de leur pensée particulièrement délicate. Le terme de ‘concorde’ serait sans doute plus approprié !
En effet, dès le début des années 70, leurs trajectoires intellectuelles convergent l’une vers l’autre, se touchent, s’entrelacent, résonnent et interfèrent. Au-delà d’une proximité physique, puisqu’ils enseignent dans les mêmes lieux, de profondes similitudes se révèlent dans leurs travaux respectifs. Méridionaux tous les deux, nés entre les deux guerres, sensibles aux mêmes influences, ils ont lu la philosophie de Simone Weil chacun avec beaucoup d’intérêt. Nul doute que sa quête de vérité les ait fortement inspirés l’un comme l’autre. De fait, soucieux de la noirceur de l’âme humaine, passionnés de connaissance et de culture, convaincus de la nécessité d’une forme de dévoilement par la voie (ou la voix) des sciences, coudre leurs pensées à la trame commune de nos savoirs est dès lors apparu comme une perspective évidente.
Que ce soit sur des questions épistémologiques, tenant à la fusion des disciplines, ou sur le fondement des cultures et des sociétés, abreuvées de la violence qu’engendre la mimésis, nous pouvons à juste titre parler de philosophies de la concordance. A la confluence des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l’histoire, des sciences humaines, de la mythologie et de l’herméneutique, ils vont féconder de leur génie le projet anthropologique d’une nouvelle alliance.
De surcroît, la profonde estime qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre n’a pu qu’amplifier cette communion des esprits. Parce que c’était René Girard et parce que c’était Michel Serres, ainsi pourrait-on dire !
Olivier Joachim est professeur agrégé de physique en classes préparatoires au lycée Saint-Louis.
Jeudi 12 mai 2022 : Christine Orsini
“Pascal au risque de la théorie mimétique”
Trois siècles exactement séparent René Girard (Avignon, 1923) et Blaise Pascal (Clermont, 1623). Trois siècles au cours desquels la civilisation occidentale est devenue la première civilisation athée de l’histoire. Quand on lit les Pensées, aujourd’hui, on célèbre un immense écrivain qui a une vision « tragique » de la condition humaine.
René Girard n’a recouru à Pascal que dans Achever Clausewitz co-écrit avec Benoît Chantre ; de plus, son anthropologie à vocation scientifique n’est pas dans le style de la « vraie philosophie » qui se dégage des Pensées ; alors pourquoi une lecture girardienne de Pascal ?
On verra, je l’espère, qu’il y a bien des raisons d’opérer un rapprochement entre les thèmes pascaliens et les thèses de la théorie mimétique. Mais notre première motivation a été de contrer les lectures anti-religieuses de Pascal par une lecture qui prend au sérieux la Révélation évangélique, centre de gravité aussi bien de l’entreprise girardienne que des « fragments » de l’ouvrage projeté par Pascal, une « Apologie de la religion chrétienne ».
Agrégée de philosophie et secrétaire générale de l’Association Recherches mimétiques (ARM), Christine Orsini a contribué à "René Girard et le problème du mal "(Grasset, 1982) et au colloque de Cerisy « Autour de René Girard » en 1983. Elle est également l’auteur de "La Pensée de René Girard "(Retz, 1984) et récemment "René Girard" (Coll "Que sais-je" PUF, 2018).
Mercredi 19 octobre 2022 : Andreas Wilmes
“Maîtres, esclaves, et doubles monstrueux. Girard critique de Hegel”
René Girard n’a jamais nié que l’écriture de son premier livre a été influencée par le « climat hégélien des années 1950 ». Dès Mensonge Romantique et vérité Romanesque, il s’est néanmoins efforcé de distinguer sa pensée de celle de Hegel. Ses critiques à l’endroit du philosophe allemand seront jugées fort peu convaincantes par ses contemporains. Pour Mikkel Borch-Jacobsen, la théorie du désir mimétique serait avant tout une relecture (certes brillante) des cours d’Alexandre Kojève sur la Phénoménologie de l’Esprit.D’après Philippe Lacoue-Labarthe, Girard, contrairement à Georges Bataille, aurait évité toute forme de confrontation sérieuse avec la philosophie hégélienne. L’anthropologue français n’a eu de cesse de vouloir couper court à ces divers malentendus. Son dernier ouvrage, Achever Clausewitz, où il revient de manière détaillée sur son opposition à Hegel, en constitue sans doute la preuve la plus éclatante.
Dans cette conférence, nous nous demanderons en premier lieu d’où viennent ces divers malentendus autour de la prétendue dimension hégelienne de la théorie mimétique. A notre sens, c’est pour avoir critiqué Hegel en dehors des sentiers battus de l’anti-hégélianisme français que les idées de Girard sont longtemps restées incomprises…
Andreas Wilmes est docteur en philosophie, directeur de la revue Philosophical Journal of Conflict and Violence.
Mercredi 16 novembre 2022 : Stéphane Vinolo
“Spinoza et Girard : les mécaniciens du désir”
Spinoza ne fait pas partie des philosophes souvent cités par René Girard, comme peuvent l’être Platon, Hegel ou Sartre. Il y a là quelque chose de tout à fait surprenant puisque non seulement Spinoza est un penseur du désir, au point de faire de celui-ci l’essence même de l’homme (Ethique, III, Appendice), mais en plus parce que l’Ethique développe toute une théorie du mimétisme des affects. De plus, tout au long du Traité Théologico-Politique, Spinoza n’a eu de cesse de signaler l’importance du Christ, le plus grand des philosophes.
Certes, les conséquences que Spinoza tire du mimétisme sont radicalement différentes de celles que propose René Girard puisque ce dernier fait de la démocratie le régime le plus mimétique et donc le plus violent qui soit, là où Spinoza déclare le caractère absolu en tout du décompte des votes. Il y a donc, entre Spinoza et Girard, des liens complexes et pourtant constants. En confrontant les deux auteurs, nous pourrons donc non seulement préciser leurs conceptions du désir et du mimétisme mais peut-être aussi révéler une filiation souterraine de la pensée de Girard.
Stéphane Vinolo est docteur en philosophie de l’Université de Bordeaux, et docteur en théologie de l’Université de Strasbourg. Il enseigne à l’Université Catholique de Quito en Equateur.
"Comment la vision girardienne des relations humaines peut éclairer des pratiques professionnelles."
successivement par un manager, professeur de lycée, un magistrat, un médecin, un directeur d'association, un médiateur social...
Jeudi 11 février : Jean-Louis Salasc
"Ce que la théorie mimétique peut dire aux managers"
Jean-Louis Salasc propose ainsi à la fois une introduction à la pensée de René Girard, et une réflexion sur sa propre expérience de terrain en tant que dirigeant d'entreprise.
Sa conférence s'adresse donc tant aux connaisseurs de l'oeuvre de Girard qu'à ceux qui souhaitent la découvrir. N'hésitez donc pas à inviter d'autres personnes.
Ingénieur de formation, Jean-Louis Salasc a exercé des fonctions managériales (manager de terrain, directeur d'unités opérationnelles) et d'état-major (directeur de la veille stratégique) dans un grand groupe énergétique français. Il anime le "Blog émissaire" de l'ARM.
Jeudi 25 mars : Joël Hillion
"Mimétisme, empathie et éducation "
Apprendre, c’est imiter. Puisqu’imiter est « inné », comment se servir de cette capacité ? Peut-on la développer ? René Girard parle de mécanisme mimétique, « mécanisme » qui a été confirmé par la découverte des neurones miroirs. Pour parvenir à sa pleine humanité, le petit d’homme a besoin d’un environnement humain. On parle de « figure d’attachement ». D’où l’importance centrale du modèle.
Comment notre « cerveau empathique » fonctionne-t-il ? Peut-on faire face à la « mauvaise imitation », celle qui conduit à la rivalité entre pairs et à l’exclusion ? Comment plutôt valoriser l’imitation ? Quels sont les moyens de l’éducateur, professeur ou parent ? Le « choix du modèle » est déterminant. Peut-il être accompagné ? Comment éviter la fascination pour les « mauvais modèles » ? Le mot « pédagogue », au sens de « guide », prend dès lors tout son sens.
Joël Hillion, né en 1945, a enseigné en lycée et classes préparatoires.Il est l’auteur de plusieurs essais sur l’éducation.http://joel-hillion.eklablog.com/
Jeudi 20 Septembre 2021 : Denis Salas
"Le droit de faire mourir au XXIè siècle"
Réflexions à l’occasion du 40e anniversaire de l’abolition de la peine de mort
Cette conférence voudrait renouveler l’approche traditionnelle de la peine de mort sous l’angle plus large du droit de faire mourir. À long terme, on observe un mouvement amorcé par Cesare Beccaria, fondateur du droit pénal moderne, à la fin du xviiie siècle, qui tend à l’abolition de cette peine au fur et à mesure que l’emprise de l’État monarchique s’affaiblit et que la société exige des peines plus utiles qu’effrayantes. À plus court terme cependant, la peine de mort subsiste et même se renforce dans les régimes à État fort alors que les djihadistes en ont fait une arme de propagande. Cette conjoncture incite les démocraties à radicaliser leurs réponses en usant du droit de faire mourir sous des formes nouvelles dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. La pensée de René Girard viendra à l’appui de notre réflexion au cours de laquelle nous croiserons aussi celles de Michel Foucault et de Jacques Derrida.
Denis Salas est magistrat et essayiste. Il dirige la revue Les Cahiers de la Justice et préside l’Association Française pour l’Histoire de la Justice. Il a notamment publié en 2018 "La Foule innocente" (DDB).
Denis Salas a dirigé avec Benoît Chantre le colloque "Justice et terrorisme - Entre mémoire victimaire et dépassement de la violence" , qui a eu lieu à la BnF le 19 décembre 2018.
Jeudi 18 novembre 2021 : Hervé van Baren
"La théorie mimétique et le milieu associatif"
Le milieu associatif bénéficie d’une bonne image. D’abord parce qu’une association est par principe étrangère à l’appât du gain. Ensuite parce que l’ « objet social » d’une association porte bien son nom. Les associations ont en commun une fonction sociale positive, la volonté de « rendre le monde meilleur ».
Pourtant les associations et les ONG sont composées d’hommes et de femmes, c’est-à-dire de personnes exposées aux effets pervers du mimétisme, l’envie, la rivalité, le ressentiment. Comme toutes les communautés humaines, les associations sont le théâtre de bien des conflits. Comment les détecter, les comprendre et, dans la mesure du possible, les résoudre et les prévenir ?
Quant aux acquis positifs du mimétisme, l’émulation, l’empathie, la médiation externe, peuvent-ils expliquer le don de soi, la générosité et l’engagement social des fondateurs, membres, employés et bénévoles du secteur associatif ? La générosité des donateurs ? (8,5 milliards d’euros en France en 2019)
A travers quelques exemples vécus et avec l’éclairage de la théorie mimétique, Hervé van Baren tentera d’apporter un début de réponse à ses questions.
Hervé van Baren, 58 ans, vit en Belgique. Ingénieur, il a été cadre dans l’industrie pendant 15 ans. Aujourd’hui il est actif à différents niveaux dans deux fondations et trois associations. Il est contributeur du blog émissaire de l'ARM.
>>> ENREGISTREMENTS DES CONFERENCES
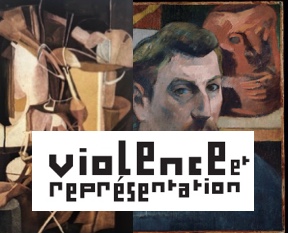
dirigé par Jérôme Thélot et Jean Nayrolles
Vers de nouvelles voies d’interprétation des phénomènes artistiques à la lumière des analyses girardiennes de la violence et du sacré
> PRESENTATIONS ET ENREGISTREMENTS DES CONFERENCES (lien):
Samedi 20 février 2021 : Jean Nayrolles
"ART, VIOLENCE ET SACRE".
Samedi 20 février 2021 : Jean Nayrolles
"Portrait de l'artiste au centre du monde".
Samedi 13 mars 2021: Jérôme Thélot
" Géricault. Généalogie de la peinture "
Jérôme Thélot est essayiste et traducteur, et professeur de littérature française à l’Université de Lyon.
Samedi 10 avril 2021: Olivier Rey
" Ce que la Pietà d’Avignon donne à voir et à entendre "
Olivier Rey est mathématicien et philosophe, chercheur au CNRS, enseignant en philosophie à l’Université Paris 1
Samedi 8 mai 2021: Jeanne Dorn
"Bonnefoy et Poussin"
Jeanne Dorn est doctorante en histoire de l'art à l'université Paris X Nanterre, où elle prépare une thèse sur la pensée de l'art d'Yves Bonnefoy.
Samedi 12 juin 2021: Jean-Marc Bourdin
"Marcel Duchamp ou comment sacrifier (à) la mode du refus
Jean-Marc Bourdin a soutenu une thèse de doctorat en philosophie sur René Girard à l'Université Paris-VIII.
Samedi 11 septembre 2021 : Rémi Labrusse
« Violence et Néolithique : un mythe moderne ? »
Rémi Labrusse est professeur d’histoire de l’art contemporain (Paris Nanterre)
Samedi 9 octobre 2021 : Didier Laroque
« Le temple dorique et le sacrifice »
Didier Laroque est professeur d'esthétique à l'Ecole nationale supérieure d'architecture Paris-Val de Seine
Samedi 13 novembre 2021: Table ronde
Table ronde avec tous les intervenants du cycle et Lucien Scubla, enthropologue.
L'actualité éclairée par la pensée de René Girard.
(https://emissaire.blog/)
N'hésitez pas à partager vos avis !
Vous pouvez vous inscrire sur le site du blog pour être tenus informés de chaque nouvelle parution.