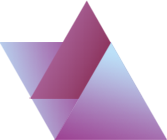"Qu’est-ce que le moi ? Une lecture girardienne de Pascal"
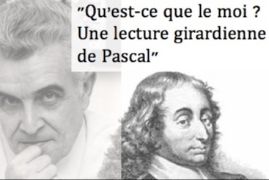
René Girard est devenu le théoricien des origines de la culture à partir d’une critique radicale de l’individualisme moderne, dont il a trouvé le modèle dans la grande littérature, de Cervantès à Proust. Loin d’être reconnu et célébré comme « le Darwin des sciences humaines », ce penseur a été marginalisé par le milieu universitaire. On lui conteste ses méthodes et surtout les conclusions de sa lecture anthropologique de la Bible. Pour Girard, c’est sur le fondement d’une théorie de l’homme contenue dans le christianisme que l’essor de la pensée scientifique a été rendu possible : on est loin de l’esprit des « Lumières » et de sa croisade contre l’obscurantisme, représenté par la religion.
En amont de la philosophie des Lumières, trois siècles avant l’anthropologie girardienne, les Pensées de Pascal font écho à la critique radicale des illusions de la raison et des mensonges de l’orgueil entreprise par Girard. La déconstruction du « moi », par exemple, est déjà effectuée chez Pascal, qui prévient, en vain, les libertins des affres qu’ils vont subir en entrant dans ce qui ne s’appelle pas encore le « mensonge romantique » de surestimation (ou de sous-estimation) de soi.
Les Pensées sont les fragments sublimes d’une anthropologie destinée à servir le projet d’une Apologie du christianisme. C’est pourquoi un rapprochement entre ces deux « penseurs » qu’on n’arrive pas à classer (Pascal, qui pense que « la vraie philosophie se moque de la philosophie » et Girard, qui pense qu’une vraie science de l’homme se moque des sciences humaines) me semble pertinent. De plus, lire ou relire Pascal, c’est se retrouver devant des vérités sur soi, sur sa condition d’homme, si simples et si profondes qu’elles ont un effet euphorisant ; elle procurent l’immense plaisir d’avoir l’impression de devenir plus intelligent, de passer du statut de « demi-habile » au statut d’« habile ». Et pour ceux qui ont la foi, de passer du statut de « dévot » à celui de « vrai chrétien ». Si c’était vrai, si ce n’était pas qu’une impression, ce n’est pas d’un progrès qu’il s’agirait mais bien d’une conversion, au sens girardien du mot.
Agrégée de philosophie et secrétaire générale de l’Association Recherches mimétiques (ARM), Christine Orsini a contribué à René Girard et le problème du mal (Grasset, 1982) et au colloque de Cerisy « Autour de René Girard » en 1983. Elle est également l’auteur de "La Pensée de René Girard "(Retz, 1984). Christine Orsini vient de faire paraître "René Girard" (Coll "Que sais-je" PUF).