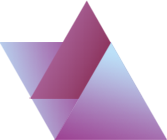Charles Darwin

Dans quelles circonstances avez-vous fait connaissance avec l'oeuvre de Darwin, notamment "L'Origine des espèces" ?
Je l'ai lue dans ma jeunesse et j'ai été impressionné par sa façon de penser : une attention très grande aux détails, à la vraisemblance et à la cohérence. Je l'ai relue récemment et j'ai à nouveau été frappé par ce qu'il décrit lui-même comme "un long raisonnement du début à la fin".
Diriez-vous que ce livre a changé le monde ?
Sur le plan de la pensée, il est évident qu'il en a changé l'interprétation. Pour moi, il constitue un idéal de livre scientifique, sans lequel je n'aurais pu développer mes idées.
Ce qui est frappant, c'est que l'opposition au darwinisme s'est en quelque sorte évaporée. Un peu comme si on voulait s'opposer à Newton ou à Einstein dans leur domaine. La première fois que je l'ai lu, l'attitude était totalement différente. Il y avait encore une possibilité d'antidarwinisme réelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, que l'on soit croyant ou pas : Jean Paul II n'a-t-il pas dit qu'il voyait dans le darwinisme "plus qu'une hypothèse" ?
Et pourtant, aux Etats-Unis, la moitié de la population continue à considérer que l'homme a été créé il y a quelques milliers d'années sous sa forme actuelle...
Oui, mais c'est sans rapport avec Darwin. Il est comme un épouvantail pour ces gens-là qui ne connaissent pas son oeuvre, et dont le niveau d'éducation est assez bas - sans vouloir les insulter. Mais on ne peut pas dire qu'en Amérique, l'antidarwinisme soit manifeste à l'université ou dans les églises, hormis chez les fondamentalistes provinciaux. Pour comprendre cette Amérique, il faut prendre en compte l'immensité même du pays, qui permet à des idées qui n'ont plus cours ailleurs de subsister.
Pour reprendre votre terminologie, peut-on dire que ce livre est né de la "rivalité mimétique" entre Charles Darwin et le naturaliste Alfred Russel Wallace (1823-1913), qui venait de lui adresser une lettre où il exposait lui aussi une théorie de la sélection naturelle ?
Je pense qu'il y avait plutôt un accord qu'une rivalité. Cette simultanéité est justement l'un des aspects passionnants de leur découverte. Elle montre qu'il y a bien une histoire des idées, et que celle-ci est plus importante que celle des individus. Le XIXe siècle est caractérisé par l'entrée du temps dans une quantité de disciplines qui le négligeaient auparavant. Darwin, au fond, a introduit systématiquement ce paramètre dans l'étude de la nature. Les conséquences de cette perspective se sont révélées peu à peu... Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que ni Darwin ni Wallace n'était pressé de publier le résultat de ses recherches.
Est-ce, pour Darwin, parce qu'il pressentait le scandale ?
Darwin écrit effectivement que sa femme est croyante et qu'il regrette de la décevoir. C'est-à-dire qu'il a une vision du darwinisme qui est vraiment celle de son époque : il a l'impression que la question principale est religieuse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, du moins dans la plupart des milieux cultivés.
Il faut bien voir qu'il y a chez lui un côté amateur, il se promène à travers les problèmes qui l'intéressent. Il aime les raisonnements bien faits, qui devaient lui prendre beaucoup de temps à formuler.
Certains darwiniens, comme le Britannique Richard Dawkins, mènent un combat athéiste. Qu'en pensez-vous ?
Je suis chrétien, et cela influence sans doute ma lecture des choses, mais je pense que l'idée que Darwin induit nécessairement l'athéisme est peu juste. C'est peut-être l'un des effets du darwinisme, mais on a pris l'habitude d'interpréter de façon beaucoup moins littérale la Genèse telle qu'elle figure dans la Bible, alors qu'au XIXe siècle, ces débats restaient vivants.
Que Darwin soit conciliable avec la religion, voilà ce qui, pour Dawkin, paraît scandaleux. Bien sûr, toutes les grandes découvertes modernes ont fini par modifier notre interprétation du religieux, mais celui-ci a toujours survécu, même s'il est beaucoup moins prégnant aujourd'hui. A mon sens, les conflits qui résultent d'attitudes religieuses et antireligieuses n'ont pas de rapports profonds avec une intelligence véritable des mécanismes de l'évolution tels qu'on les explique, ou plutôt qu'on les décrit de nos jours.
La théorie de l'évolution voit pourtant en l'homme le fruit du hasard et de la nécessité...
L'évolutionnisme voit l'homme comme un animal modifié, peut-être un peu plus que les autres, avec l'avènement du langage, l'émergence de la civilisation tout entière. Dans l'histoire de la vie selon Darwin, il y a cette ascension constante, du monocellulaire au complexe, du plus grossier au plus fin, du moins intelligent au plus intelligent, de l'inconscient au conscient. Cette évolution-là, tout le monde y croit plus ou moins volontiers aujourd'hui. C'est peut-être un reste de religion...
Darwin a été accusé d'avoir glorifié la survie du plus apte. Un philosophe comme Patrick Tort estime au contraire qu'il a montré que "par la voie des instincts sociaux, la sélection naturelle sélectionne la civilisation qui s'oppose elle-même à la sélection naturelle"...
Je ne pense pas que Darwin ait été eugéniste ou raciste. On peut souscrire à la continuité décrite par Patrick Tort : à partir d'un certain stade, le groupe va vers plus d'ordre, des institutions solides. On arrive dans une zone où l'instinct cède le pas à l'intelligence.
Y aurait-il alors moyen d'établir un lien entre sciences naturelles et humaines, et par exemple entre votre théorie du "mimétisme" et certaines découvertes biologiques ?
Pourquoi pas ? On sait que les singes possèdent plus de "neurones-miroirs" que les autres mammifères, et l'homme plus encore que les singes. Par conséquent, même si on n'en a pas la preuve, on peut faire l'hypothèse que l'intelligence, la réflexion, la capacité d'imaginer la pensée de l'autre, découlent de la présence de ces neurones. Il est bien évident que le lien entre la pensée évolutionniste et d'autres formes d'interrogations sur ce qui fait l'humanité est aujourd'hui plus fort que jamais. Pour autant, quelqu'un a-t-il fait cette synthèse ? Je ne crois pas, et j'ai l'impression que la question excite moins les esprits que par le passé.
D'un point de vue évolutionniste, quelle pourrait être la fonction de la violence, qui est, selon vous, au coeur de la société humaine ?
Je ne l'envisage pas comme un fait biologique, mais comme un fait social : la violence est contagieuse, elle se répand dans une communauté, et menace de faire exploser le groupe. Ce que je dis, c'est que le phénomène de bouc émissaire, le rassemblement mimétique contre une victime particulière, est très important en ce qu'il permet de réconcilier la communauté. La victime ressort avec des qualifications négatives, mais aussi positives, car la violence contre elle a ramené la tranquillité dans la communauté. Ce bouc émissaire, parce qu'il permet de ramener la paix, tourne à la divinité dans les religions archaïques. Je ne prétends pas résoudre pour autant la question de l'existence de Dieu à partir d'un tel raisonnement.
Mais vous seriez prêt à envisager un dieu darwinien ?
Oui, même si Darwin lui-même ne l'imaginait pas.
Propos recueillis par Hervé Morin dans l'édition du Monde des Livres (22 octobre 2009)
Un symposium intitulé "De l'animal à l'humain" explore les liens entre les théories de Charles Darwin et René Girard, les 16 et 17 octobre 2009 au Saint John's College de Cambridge
Extrait
"Or, bien que beaucoup de points soient encore très obscurs, bien qu'ils doivent rester, sans doute, inexpliqués longtemps encore, je me vois cependant, après les études les plus approfondies, après une appréciation froide et impartiale, forcé de soutenir que l'opinion défendue jusque tout récemment par la plupart des naturalistes, opinion que je partageais moi-même autrefois, c'est-à-dire que chaque espèce a été l'objet d'une création indépendante, est absolument erronée. Je suis pleinement convaincu que les espèces ne sont pas immuables ; je suis convaincu que les espèces qui appartiennent à ce que nous appelons le même genre descendent directement de quelque autre espèce ordinairement éteinte, de même que les variétés reconnues d'une espèce quelle qu'elle soit descendent directement de cette espèce ; je suis convaincu, enfin, que la sélection naturelle a joué le rôle principal dans la modification des espèces, bien que d'autres agents y aient aussi participé."
("L'Origine des espèces", p. 22.)
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/10/22/rene-girard-l-opposition-au-darwinisme-s-est-evaporee_1247687_3260.html#H01L8QEewY1Dt6MO.99