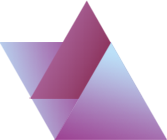Violence et représentation, Cycle de conférences, dirigé par Jean Nayrolles et Jérôme Thélot

Présentation du cycle de conférences et enregistrements
Ce cycle a été dirigé par Jean Nayrolles en 2019.
Les intervenants sont Jean-Marc Bourdin, Jeanne Dorn, Rémi Labrusse, Didier Laroque, Jean Nayrolle et Jérôme Thélot.
Parce qu’elle concerne les phénomènes humains en tant que tels, la théorie mimétique éclaire les domaines les plus divers des sciences de l’homme. Mais il ne faut pas oublier que René Girard en a élaboré la première application dans le champ de la littérature, c’est-à-dire dans une forme particulière de création artistique. À ses yeux, il n’y avait pas de différence de nature entre un savoir contenu dans un texte littéraire et un savoir forgé dans un but scientifique (à ceci près que le premier, surtout s’il émane d’un Shakespeare ou d’un Dostoïevski, offrira plus de profondeur que le second). Mais face aux autres formes d’art, en particulier face aux images, la théorie mimétique s’est montrée plus timide. Le cinéma seul semblait pouvoir en bénéficier pleinement, du fait de son contenu narratif qui l’apparente au roman.
Que la notion d’imitation, si décisive pour l’histoire de l’art, n’ait pas été explorée à la lumière de la théorie mimétique, et que, symétriquement, les anthropologues réceptifs aux questions soulevées par René Girard n’aient guère cherché à étendre leur réflexion au domaine des arts visuels, voilà qui ne laisse pas d’étonner. C’est sans doute que les enjeux de la confrontation ne se situent pas au croisement des deux sortes d’imitation, l’artistique et l’anthropologique, mais plutôt dans le renouvellement et l’élargissement des analyses prenant en compte les questions de la violence et du sacré. Du reste, l’interprétation, inaugurée par Girard à la fin de sa vie, des images retrouvées à Çatal Höyük, le célèbre site anatolien du premier urbanisme néolithique, indiquait une voie qu’on aurait tort de réserver au seul monde archaïque.
Sous le titre "Violence et représentation", ce cycle de conférences cherchera à aller plus loin dans la direction indiquée, mais aussi — espérons-le — à ouvrir de nouvelles voies d’interprétation. Une anthropologie de l’art qui situe les images dans une économie de la violence et du sacré, une sociologie de l’art qui situe l’œuvre d’art dans le monde des objets du désir, une phénoménologie de l’art qui situe les chefs-d’œuvre de la peinture ou de la sculpture dans une phylogenèse des pratiques du peintre et du sculpteur, formeront l’horizon de ces travaux.
"ART, VIOLENCE ET SACRE" par Jean Nayrolles
Nombre de mythes conservent le souvenir à peine voilé de ce phénomène de substitution sacrificielle pourtant demeuré inaperçu. De la contre-violence primordiale qui s’y dessine, les ressorts seront oubliés mais n’en demeureront pas moins inscrits dans l’histoire de l’art telle qu’elle s’est déployée jusque dans la culture moderne.
C’est à suivre les recompositions successives de ce lien noué aux origines entre art et violence qu’invitera cette conférence. L’enquête sera menée jusqu’au seuil de la modernité où l’on voit la structure victimaire s’inverser et l’artiste romantique se désigner lui-même comme objet de réprobation. Dès lors, ce que l’on appelle art moderne apparaîtra comme une production qui, pour advenir dans toute sa force disruptive, doit recréer fantasmatiquement le cercle d’hostilité propre au dispositif sacrificiel.
C’est son parcours d’historien de l’art qui a conduit Jean Nayrolles sur un terrain situé aux confins de l’histoire et de l’anthropologie. Parti de l’étude des phénomènes de redécouvertes artistiques, il s’est ensuite consacré à des recherches sur l’historiographie des origines de l’art depuis l’Antiquité, formant une sorte d’archéologie du primitivisme moderne. La découverte à cette occasion du lien entre art et violence, lien qui ne relève pas de l’ordre des discours ni d’une simple histoire des représentations iconographiques mais bien d’une étiologie des fondements de la culture, est à l’origine des deux livres qu’il a récemment publiés aux éditions Kimé : "Du sacrificiel dans l’art "(2019) et "Le Sacrifice imaginaire. Essai sur la religion de l’art chez les Modernes "(2020).
"PORTRAIT DE L'ARTISTE AU CENTRE DU MONDE" PAR JEAN NAYROLLES
La sphère de l’art n’a jamais cessé de se couler dans la matrice anthropologique dont est toujours sortie l’instance sacrée, or cette matrice n’est autre que la structure de la violence émissaire.
La création artistique a partie liée avec celle-ci depuis des temps très reculés qui, à en croire de nombreux mythes, virent les premiers corps sculptés ou peints se substituer aux corps des victimes promises à un rituel de mort. De cette genèse refoulée, il n’est surtout resté, jusque dans les premiers siècles modernes, qu’une vive fascination pour la puissance des anciennes oblations sanglantes dont l’art et la littérature se sont fait amplement l’écho. Mais avec la révolution romantique, la structure sacrificielle connaît à nouveau une profonde mutation. Délaissée en tant qu’image extérieure, elle se voit à la fois intériorisée par les artistes et renversée dans sa forme. Alors que la victime était autrefois désignée par un rassemblement unanime, voilà qu’elle s’auto-désigne désormais en définissant elle-même le cercle d’hostilité refermé autour de sa personne.
S’attribuant la place située au centre de ce cercle extensible à l’infini, l’artiste moderne se retrouve, symboliquement, au centre du monde. Ce faisant, il apparaît comme absolument unique au sein de la communauté humaine. Et c’est de cette unicité que la création moderne tirera toute sa force. Conçue à distance du cercle d’hostilité, l’œuvre d’art se déploie désormais hors du sens et du goût communs, puisant dans le schéma ainsi formé les conditions de sa radicale nouveauté.
" GÉRICAULT. GÉNÉALOGIE DE LA PEINTURE " PAR JERÔME THELOT
On connaît Géricault pour ses peintures de chevaux transis par la foudre, pour ses portraits d’enfants les plus troublants de l’art français, pour ses têtes de fous qui n’ont aucun équivalent dans l’histoire de la peinture, et pour son immense tableau révolutionnaire, Le Radeau de la Méduse, chef-d’œuvre du Romantisme, protestation de la vie jusque dans la mort. On sait aussi que son existence fut brève et fulgurante, son œuvre inachevée et inspirée, et que sa mémoire fut révérée par tous les artistes du XIXe siècle.
Mais à la faveur du renouveau des études sur ce peintre, on peut montrer maintenant que Géricault fut en outre un penseur, aussi grand qu’il fut grand artiste ; et on peut postuler à titre d’hypothèse herméneutique que sa pensée fut une généalogie de la peinture.
On découvre d’abord dans ses premiers ouvrages de 1808 à 1814 son premier tourment qui fut de questionner la différence entre l’homme et l’animal, son travail se définissant alors comme conscience de soi de la peinture, où l’existence humaine sort de la vie par la représentation. Ensuite, de 1814 à 1817, en particulier dans les études exécutées en Italie, on voit que l’artiste remonte jusqu’au fondement de la représentation dans la violence Puis l’analyse du tableau de 1819, Le Radeau de la Méduse, révèle que sa généalogie de la peinture s’y parachève, exhibant dans la vie originaire la provenance de la violence. Au cours des années d’avant sa mort en 1824, éclate enfin la force la plus audacieuse dont le peintre fut doué – la force de la compassion –, qui fait la beauté irrésistible de ses lithographies, de ses portraits et de ses études de tête, où, abaissant son art, il en a réalisé la possibilité la plus féconde, témoignant de la présence d’autrui et de la transcendance de cette présence par rapport à toute image. Ainsi se manifeste l’unité profonde de l’œuvre entière de Géricault : connaissance de soi, critique de la violence, affirmation de la vie et lucidité de la compassion.
Jérôme Thélot, ancien élève d’Yves Bonnefoy au Collège de France, disciple aussi de René Girard et de Michel Henry, est essayiste et traducteur, et professeur de littérature française à l’Université de Lyon. Ses écrits portent sur la poésie romantique et moderne, sur la philosophie de l’affectivité, et sur les conditions de l’image. Il développe auprès des auteurs qu’il interroge, en particulier Baudelaire, Rousseau, Dostoïevski, Sophocle, une poétique générale qui remonte à la fondation de la parole et de la représentation dans la violence originelle. Ses travaux sur la photographie ont d’abord décrit les conséquences de l’invention de celle-ci sur la littérature (Les inventions littéraires de la photographie, PUF, 2003), puis les caractères propres de sa phénoménologie (Critique de la raison photographique, Les Belles Lettres / Encre marine, 2009). Ses « Notes sur le poétique » (Un caillou dans un creux, Manucius, 2016) explicitent les attendus de sa recherche.
" CE QUE LA PIETÀ D’AVIGNON DONNE À VOIR ET À ENTENDRE " PAR OLIVIER REY
Pour l’historien de l’art Wolfgang Schöne, l’histoire des images de Dieu en Occident fut marquée par une phase de visibilisation croissante, culminant dans la seconde moitié du XVe siècle, suivie d’une phase de visibilisation décroissante, reconduisant à l’invisible. À travers le mystère de l’Incarnation, Dieu se donnait toujours plus à voir dans la forme humaine ; mais quand la forme humaine devint la véritable référence – comme c’est le cas au plafond de la Sixtine, peint par Michel-Ange au début du XVIe siècle –, celle-ci devint également inapte à figurer Dieu. Peinte au milieu du XVe siècle, la Pietà d’Avignon, d’Enguerrand Quarton, se situe à peu près au point culminant de la visibilité divine. Appartenant encore à l’ère de l’image, mais précédant de très peu l’ère de l’art, cette œuvre nous donne la possibilité d’apprécier, à partir d’elle, l’ensemble de la trajectoire.
Après avoir étudié à l’École polytechnique, Olivier Rey a été officier de marine, puis a obtenu un doctorat de mathématiques. Depuis 1989 il est chargé de recherche au CNRS, au sein duquel il est passé, en 2009, de la section mathématiques à la section philosophie. Il est membre de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques, et enseigne à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il a reçu le Prix Bristol des Lumières 2014, pour "Une question de taille", Stock, 2014; le Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac 2015; le Prix Jacques Ellul 2019, pour "Leurre et malheur du transhumanisme", DDB, 2018.
"Poussin, René Girard et Yves Bonnefoy" PAR JEANNE DORN
"Des premières Bacchanales marquées d’un érotisme franc, en passant par le "Massacre des Innocents "de Chantilly, jusqu’aux œuvres charnières des années 1630, en particulier "La Peste d’Asdod" et l’"Enlèvement des Sabines", l’œuvre de Poussin est de part en part traversée par la question de la violence. Au cœur des préoccupations du peintre, celle-ci gagne à être scrutée dans l’analyse de certaines œuvres majeures pour aboutir au chef d’œuvre de 1640, "Les Bergers d’Arcadie" du Louvre. Ce dernier tableau, peint juste avant le départ pour Paris ordonné par le roi, récapitule le cheminement de l’artiste, et délivre son savoir du fondement de la représentation dans la violence."
Jeanne Dorn est doctorante en histoire de l'art à l'université Paris X Nanterre, où elle prépare une thèse sur la pensée de l'art d'Yves Bonnefoy.
« VIOLENCE ET NÉOLITHIQUE : UN MYTHE MODERNE ?" par RÉMI LABRUSSE
Depuis son invention dans les années 1860, la notion de néolithique, par opposition au paléolithique, a été associée à l’idée de violence sociale. Simultanément, on a identifié et admiré ce qu’on pensait être les expressions matérielles d’un pouvoir gagné et assuré par la force : armes, constructions monumentales.
Depuis son invention dans les années 1860, la notion de néolithique, par opposition au paléolithique, a été associée à l’idée de violence sociale. Simultanément, on a identifié et admiré ce qu’on pensait être les expressions matérielles d’un pouvoir gagné et assuré par la force : armes, constructions monumentales. Ainsi l’ancien étonnement devant les haches polies ou les mégalithes a-t-il nourri – à tort ou à raison –, à la fin du siècle, la pensée d’une « révolution néolithique », pensée destinée à se diffuser tout au long du XXe siècle et jusqu’aujourd’hui. Cette diffusion, cependant, ne s’est pas faite sans contradictions : non seulement, ses inflexions ont évolué mais, continûment, elles ont recelé des postulations opposées, projetant sur l’horizon dit « néolithique » l’attitude ambivalente de la modernité à son propre égard. A l’admiration pour l’essor spectaculaire de la puissance humaine n’a cessé de s’accoler l’inquiétude, sinon l’angoisse, sensible autant dans les réflexions théoriques des archéologues et penseurs de la préhistoire que dans un certain nombre de créations artistiques, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Une énigme, en particulier, a saisi les imaginations : celle d’une brusque – ou supposée brusque – schématisation des images, allant de pair avec une accélération des conquêtes techniques. Qu’en est-il aujourd’hui de cette pensée moderne du néolithique ? En quoi et pourquoi se démarque-t-elle de ses premières formulations d’il y a un siècle et demi, tout en en étant fondamentalement tributaire ?
Rémi Labrusse est professeur d’histoire de l’art contemporain (Université Paris Nanterre).
MARCEL DUCHAMP OU COMMENT SACRIFIER (À) LA MODE DU REFUS PAR JEAN-MARC BOURDIN
En 1912 se produit un événement confidentiel et rétrospectivement risible qui détermine une bifurcation sans précédent de l’histoire de la représentation artistique. Cet “effet papillon” a pour origine la demande faite à Marcel Duchamp par quelques collègues peintres et ses frères de retirer de la section cubiste du Salon des indépendants une toile intitulée Nu descendant un escalier n° 2 qui y a été pourtant officiellement admise et y est déjà accrochée. Le destin de cette toile est remarquable : dès l’année suivante, lors du premier salon d’art moderne qui se tient sur le continent américain à New-York, elle connaît le succès de scandale auquel aspire tout artiste avant-gardiste, la réhabilite et lui donne d’emblée accès à la postérité.
Dans la décennie qui suit, Duchamp digère en solitaire cet incident qui lui a, selon ses dires, “un peu tourné les sangs” et le sublime en une méditation profonde sur le processus créatif et le destin de l’artiste. Ce travail, anthropologique autant qu’introspectif, prépare le terrain pour remettre, un demi-siècle plus tard, une préoccupation spirituelle au coeur de la création artistique : l’art contemporain qualifié de conceptuel est ainsi né pour l’essentiel des efforts d’un individu en marge du monde de la peinture professionnelle dont il avait été - et s’était de ce fait lui même - exclu. Un siècle plus tard, cet anartiste, tel qu’il se dénommait et qui tenait avant tout à son unicité, ne voulait pas de progéniture et rejetait toute idée de faire école, est devenu sans conteste la divinité tutélaire de la scène artistique mondialisée. Une anecdote dérisoire s’est ainsi transmuée, pour le meilleur et pour le pire, en événement fondateur d’une révolution du regard sur le monde et ses représentations, la plus radicale qui soit.
Jean-Marc Bourdin a soutenu en 2016 une thèse de doctorat en philosophie à l'Université Paris-VIII intitulée La rivalité des égaux. La théorie mimétique, un paradigme pour l’anthropologie politique ? Il a publié Duchamp révélé en 2016 et en 2018 René Girard, philosophe politique malgré lui ainsi que René Girard, promoteur d’une science des rapports humains.